Introduction : deux mondes, une même passion pour la création
Le jour, je suis Product Manager : un métier où chaque décision est pesée, chaque fonctionnalité testée, chaque priorité justifiée par des données. Le soir, je deviens compositeur de musique électronique : un univers où l’instinct prime, où les règles sont celles que je me fixe, et où l’échec n’est qu’une étape vers une nouvelle exploration sonore. Ces deux passions, en apparence opposées, se nourrissent l’une de l’autre. L’une m’apprend la rigueur et l’efficacité, l’autre me rappelle l’importance de la liberté et de l’audace.
En juillet 2025, j’ai lancé Connected Dreams, une suite musicale de 21 morceaux explorant un thème qui me fascine : « Et si les robots avaient des rêves ? ». Ce projet, ma seconde expérimentation musicale après « 60 minutes » sorti il y a plus de deux décennies, est bien plus qu’une simple aventure artistique. C’est une réflexion sur l’itération, la technologie, la collaboration, et surtout, sur la liberté de créer sans compromis. Mais c’est aussi une plongée dans les réalités du monde musical contemporain : les KPI, le marketing digital, et la pression des plateformes. Comment concilier l’âme d’un artiste et les exigences d’un marché de plus en plus data-driven ? Comment rester fidèle à sa vision tout en jouant le jeu des algorithmes ? Finalement en quoi ma formation de Product Manager me sera ici utile ?
Dans cet article, je vous emmène dans les coulisses de ces deux univers. Vous découvrirez comment le Product Management a transformé ma façon de gérer mes projets musicaux, et comment la musique, à l’inverse, m’a appris à innover avec audace dans mon métier. Vous verrez aussi comment, à 45 ans, je me lance dans l’aventure la plus ambitieuse de ma vie musicale, en m’interrogeant : faut-il sacrifier une partie de son âme pour exister à l’ère du streaming ?
Le processus créatif : de l’idée au produit, du concept au morceau
En Product Management : l’art de l’itération guidée par les données
En tant que Product Manager, mon quotidien est rythmé par un cycle bien précis : recherche utilisateur, idéation, prototypage, tests, itérations. Chaque produit naît d’un problème à résoudre, se construit par étapes, et évolue en fonction des retours et des données.
- La recherche utilisateur est la pierre angulaire. Avant de concevoir quoi que ce soit, il faut comprendre les besoins, les frustrations, les attentes. Cela passe par des interviews, des analyses de données, des tests utilisateurs. L’objectif ? Valider une hypothèse avant d’investir des ressources.
- Le prototypage permet de matérialiser une idée rapidement, souvent avec des outils comme Figma ou des MVP (Minimum Viable Product). L’idée n’est pas de créer un produit parfait du premier coup, mais de tester, apprendre, et ajuster.
- Les feedbacks sont essentiels. Ils guident les décisions, même quand elles impliquent de pivoter ou de repartir de zéro. Un produit n’est jamais figé : il vit, s’adapte, et se perfectionne au fil des versions.
Exemple concret : Lors du développement d’une nouvelle fonctionnalité pour une application, nous avions imaginé un parcours utilisateur complexe. Après des tests, nous nous sommes rendu compte que les utilisateurs abandonnaient à mi-chemin. Résultat ? Nous avons simplifié l’interface, réduit le nombre d’étapes, et le taux de conversion a bondi de 30 %.
L’itération est au cœur de tout. Une application, une fonctionnalité, un service ne sont jamais « terminés ». Ils évoluent, s’enrichissent, et parfois, se réinventent complètement. Le produit est un organisme vivant, et le Product Manager en est le gardien.
En composition musicale : l’art de l’itération guidée par l’instinct
Quand je compose, le processus est à la fois similaire et radicalement différent. Ici, pas de données, mais des émotions, des intuitions, et une quête permanente de sonorités inédites.
- L’inspiration peut venir d’un rêve, d’un paysage, d’une conversation, ou même d’un bug sonore accidentel. Contrairement au Product Management, il n’y a pas de brief initial. Juste une idée, une ambiance, une envie.
- L’esquisse ressemble au prototypage : je pose des accords, des rythmes, des mélodies, souvent de manière chaotique. Puis vient l’arrangement, où je structure, je supprime, j’ajoute, jusqu’à ce que le morceau « respire ».
- Le mixage et le mastering sont des étapes techniques où la précision compte autant que l’émotion. Un mauvais mix peut tuer une bonne idée, tout comme une mauvaise UX peut gâcher un produit prometteur.
- Les retours existent aussi, mais ils sont subjectifs. Un morceau peut plaire à certains et laisser les autres indifférents. Et c’est très bien ainsi : l’art n’a pas à plaire à tout le monde.
Comme en Product Management, j’itère. Un morceau peut connaître plusieurs versions, plusieurs masters, plusieurs collaborations. Je peux le rééditer, le remixer, ou le laisser de côté avant de lui donner une seconde vie. Pour Connected Dreams, j’ai commencé par une esquisse très minimaliste du premier morceau. Après plusieurs versions et des retours de proches, j’ai ajouté des couches sonores, modifié la structure, et même intégré des éléments de sound design inspirés par des rêves de robots. Le résultat final est très différent de la première ébauche, mais c’est cette liberté d’itérer sans contrainte qui rend le processus si grisant.
Différence majeure : En musique, je n’ai pas à justifier mes choix. Si je veux ajouter un son dissonant, un silence de 10 secondes, ou un changement de rythme abrupt, je le fais. Personne ne me demandera de prouver que cela « convertit » mieux.
Il en est sans doute différemment pour les « chansons » crées selon un canva permettant de toucher le grand public, autotune à fond, et même là le succès n’est jamais garanti.
Comparaison : itération et liberté
Points communs :
- Dans les deux cas, rien n’est jamais définitif. Un produit comme un morceau peuvent être retravaillés, améliorés, réinterprétés.
- L’expérimentation est reine. En PM, on teste des fonctionnalités ; en musique, on explore des sons, des plugins, des structures.
- L’adaptation est une compétence clé. Savoir écouter, ajuster, et parfois tout recommencer.
Différences :
- En PM, les décisions sont souvent collectives et data-driven. En musique, elles sont personnelles et instinctives.
- En PM, le but est de résoudre un problème. En musique, il est de provoquer une émotion, même si elle est ambiguë ou incomprise.
Réflexion : Cette liberté est à la fois libératrice et angoissante. Libératrice, car je n’ai de comptes à rendre à personne. Angoissante, car je suis seul juge de la qualité de mon travail et je dois assumer / digérer les critiques qui peuvent m’être faites, sans vaciller et cesser de croire.
Gestion de projet et organisation : entre roadmaps et sessions studio
En Product Management : méthodologies et outils
La gestion de projet en PM repose sur des méthodologies éprouvées : Agile, Scrum, Kanban. Chaque sprint est planifié, chaque tâche priorisée, chaque livrable validé.
- Les outils (Jira, Trello, Notion) sont indispensables pour suivre l’avancement, aligner les équipes, et respecter les deadlines.
- La priorisation est un exercice quotidien. Il faut savoir dire non, arbitrer entre urgences et importance, et garder le cap sur la vision produit.
- La collaboration est omniprésente. Développeurs, designers, marketeurs, data analysts… Chacun a son rôle, et le PM est le chef d’orchestre.
Exemple : Lors d’un projet complexe, nous utilisions un tableau Kanban pour visualiser l’avancement des tâches. Chaque colonne représentait une étape (à faire, en cours, en review, terminé), et chaque carte une tâche précise. Cela permettait à tout le monde de voir où nous en étions en un coup d’œil.
En composition musicale : autodiscipline et flexibilité
Gérer un projet musical, surtout quand on est indépendant, demande une autodiscipline sans faille.
- La planification est essentielle, mais elle doit rester flexible. Un morceau peut prendre quelques heures… ou plusieurs mois.
- Les outils sont différents : Ableton Live, des synthétiseurs, des plugins, des carnets de notes pour capturer les idées.
- Les collaborations sont plus informelles, mais tout aussi cruciales. Un ingénieur du son, un graphiste pour la pochette, un autre musicien pour un featuring… Chaque contribution enrichit le projet.
Pour Connected Dreams, j’ai établi un calendrier de sortie (un morceau par semaine jusqu’à mes 46 ans), mais je me laisse la liberté de modifier l’ordre ou le contenu si une nouvelle idée émerge. La structure est là pour me guider, pas pour m’enfermer.
Comparaison : rigueur vs spontanéité
Points communs :
- Planifier, prioriser, respecter des échéances : ces compétences sont transférables.
- Gérer les imprévus : un bug en production comme un blocage créatif demandent de la résilience.
Différences :
- En PM, les délais sont souvent non négociables. En musique, je peux décider de prendre mon temps, ou au contraire, de sortir un morceau rapidement si l’inspiration est là.
- En PM, le succès se mesure en KPIs (taux de conversion, rétention, etc.). En musique, il se mesure en satisfaction personnelle et en réactions du public, même si elles sont qualitatives.
Réflexion : Cette flexibilité est un luxe, mais elle demande une grande discipline personnelle. Sans deadline externe, il est facile de procrastiner.
Collaboration et travail d’équipe : alignement vs liberté artistique
En Product Management : l’art du consensus
Travailler en équipe, c’est écouter, convaincre, et trouver des compromis. Les conflits sont inévitables, mais ils peuvent être constructifs si chacun reste focalisé sur l’objectif commun : livrer un produit qui apporte de la valeur.
- La communication est clé. Il faut savoir expliquer sa vision, mais aussi écouter les retours et adapter son discours.
- L’alignement est un travail constant. Tout le monde doit comprendre « le pourquoi » derrière chaque décision.
Exemple : Lors d’un désaccord entre les développeurs et les designers sur une fonctionnalité, j’ai organisé un atelier pour clarifier les enjeux. Nous avons fini par trouver une solution qui satisfaisait tout le monde, même si elle n’était pas parfaite.
En composition musicale : la magie des rencontres
Collaborer avec d’autres artistes est un échange, pas une négociation.
- Les featuring ou les remixes sont des opportunités de croiser les univers. Un autre musicien peut apporter une perspective totalement nouvelle à un morceau.
- Les retours sont précieux, mais ils ne sont jamais des ordres. Je reste maître de ma création, même si je choisis de les intégrer.
Comparaison : hiérarchie vs égalité
Points communs :
- L’écoute active et l’ouverture d’esprit sont essentielles dans les deux cas.
Différences :
- En PM, il y a souvent une hiérarchie et des rôles définis. En musique, les collaborations sont plus horizontales.
- En PM, on cherche un consensus. En musique, on accepte les divergences : elles font partie du processus créatif.
Réflexion : En musique, les collaborations sont souvent plus organiques. On travaille ensemble parce qu’on aime le projet, pas parce qu’on y est obligé.
Innovation et prise de risque : l’IA, la technologie et l’audace créative
En Product Management : innover sans tout casser
L’innovation en PM est un équilibre délicat entre prise de risque et stabilité.
- Les nouvelles technologies (IA, blockchain, réalité augmentée) ouvrent des possibilités infinies, mais elles doivent servir un besoin réel.
- Les tests A/B permettent de valider une innovation avant de la déployer à grande échelle.
Exemple : Nous avons intégré un chatbot IA pour améliorer le support client. Après plusieurs itérations, il a réduit le temps de réponse de 40 %, tout en maintenant un niveau de satisfaction élevé.
En composition musicale : l’IA et la quête de nouveaux sons
L’IA est un sujet brûlant dans le monde de la musique.
- Pour : elle permet d’automatiser des tâches techniques (mastering par exemple) et de démocratiser la création.
- Contre : elle soulève des questions éthiques (qui est l’auteur d’un morceau généré par IA ?) et artistiques (risque d’uniformisation des styles).
- Mon positionnement : j’utilise l’IA comme un outil, pas comme un remplaçant. Je me refuse d’y générer des idées mélodiques.
Comparaison : technologie au service de la création
Points communs :
- La technologie est un levier d’innovation dans les deux domaines.
- Elle pose des questions éthiques (propriété intellectuelle, déshumanisation).
Différences :
- En PM, l’IA est souvent perçue comme un gain d’efficacité. En musique, elle est parfois vue comme une menace pour l’authenticité.
Réflexion : L’IA peut être un allié, à condition de ne pas perdre de vue ce qui fait la valeur de l’art : l’émotion et l’intention humaine.
Gestion du temps et équilibre : trouver son rythme
Concilier un métier exigeant et une passion chronophage n’est pas toujours facile. Voici comment je m’organise :
- Des créneaux dédiés : je bloque des plages horaires pour la musique, comme je le ferais pour une réunion importante. Mais je saisis également les moments perdus pour saisir des idées sur mon portable.
- Des objectifs réalistes : je ne me fixe pas de sortir un album en trois mois. Je préfère avancer à mon rythme, sans pression.
- L’acceptation des phases : il y a des périodes plus intenses en PM, où la musique passe au second plan.
L’essentiel : ne pas culpabiliser. La passion doit rester un plaisir, pas une corvée.
Réflexion : Parfois, je me demande si je devrais consacrer plus de temps à la musique. Mais je sais que c’est précisément parce qu’elle reste un espace de liberté que je l’aime autant.
Les KPI pour les artistes : faut-il y accorder moins d’importance pour ne pas perdre son âme ?
À l’ère du streaming, les artistes sont de plus en plus confrontés à des indicateurs de performance : nombre de streams, taux d’engagement, croissance des abonnés, placement dans les playlists… Les plateformes comme Spotify, Apple Music, Amazon Music, ou YouTube poussent à optimiser sa présence, à « pitcher » ses morceaux, à les « marketer » comme des produits.
- Les KPI musicaux :
- Nombre de streams : un indicateur de popularité, mais qui ne reflète pas toujours la qualité artistique.
- Taux de sauvegarde : combien de personnes ajoutent votre morceau à leurs playlists ?
- Taux de skip : combien de personnes zappent votre morceau avant la fin ?
- Engagement sur les réseaux sociaux : likes, partages, commentaires.
Le dilemme : Faut-il adapter sa musique pour maximiser ces indicateurs ? Faut-il suivre les tendances, raccourcir les intros, simplifier les structures pour plaire aux algorithmes ?
Mon approche :
- Je surveille ces indicateurs, car ils donnent des informations utiles (quel morceau plaît, quel public touche-t-on ?).
- Mais je ne les laisse pas dicter ma créativité. Si un morceau est long, expérimental, ou complexe, je le sors quand même. L’art ne doit pas être réduit à une équation mathématique.
- Je me concentre sur le public qui m’aime pour ce que je fais, pas sur celui que je pourrais attirer en copiant les tendances.
Réflexion : Les KPI sont des outils, pas des fins en soi. Ils peuvent aider à comprendre son audience, mais ils ne doivent pas devenir une prison.
Le marketing digital : une nécessité à l’ère du streaming
Aujourd’hui, sortir de la musique ne suffit plus. Il faut la promouvoir, la pitcher, la vendre. Les plateformes comme Spotify ou TikTok sont devenues des marchés concurrentiels, où la visibilité dépend autant de la qualité artistique que de la stratégie marketing.
- Les pitchs aux playlists : Il faut savoir présenter son morceau en quelques phrases percutantes, mettre en avant son originalité, et cibler les bons curateurs.
- Les réseaux sociaux : Instagram, TikTok, YouTube… Il faut créer du contenu régulier, interagir avec son audience, et parfois, jouer le jeu des tendances.
- Les campagnes publicitaires : Même avec un petit budget, on peut booster un morceau sur Facebook ou Instagram pour toucher un public plus large.
Réflexion : Le marketing digital est un mal nécessaire. Il prend du temps, mais il permet de connecter avec des gens qui aiment vraiment ce que je fais.
Connected Dreams : un projet musical et une quête personnelle
Présentation du projet
Connected Dreams est une suite de 21 morceaux electro-expérimentaux explorant le thème : « Et si les robots avaient des rêves ? ». Chaque titre est une plongée dans l’univers de Rê>ON, où les imperfections sont assumées, comme dans nos propres rêves.
- Diffusion : TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music, Amazon Music…
- Collaborations : le projet est ouvert aux remixes. Je veux en faire une aventure collective.
- Objectif : me produire en live avant 50 ans.
Se réaliser à près de 50 ans : est-il trop tard ?
Lancer un projet aussi ambitieux à cet âge peut surprendre. Pourtant, je suis convaincu que la maturité est un atout.
- Pourquoi maintenant ? Parce que j’ai l’expérience, les outils, et surtout, l’envie.
- Inspirations : des artistes comme Leonard Cohen (qui a sorti un de ses meilleurs albums à 82 ans) ou Jean-Michel Jarre (toujours en tournée à 70 ans passés) ont prouvé que la créativité n’a pas de limite d’âge.
« La créativité ne prend pas sa retraite. » — Leonard Cohen.
Un hommage à Jean-Michel Jarre
Depuis mes 10 ans, Jean-Michel Jarre est une source d’inspiration. Son approche, mêlant innovation sonore, spectacle immersif et storytelling, a marqué ma vision de la musique. Le voir en concert à Bruxelles le 1er juillet 2025, avec ma compagne, a été un rappel puissant : la passion n’a pas d’âge.
Ce que j’admire chez lui :
- Son audace : il a toujours poussé les limites de la technologie et du spectacle.
- Sa cohérence : malgré les modes, il est resté fidèle à son univers tout en évoluant
- Son storytelling : ses albums sont des voyages, ses concerts des expériences totales.
Avec Connected Dreams, je m’inspire de cette philosophie : raconter une histoire avec des sons, pousser les limites de la technologie, et créer des émotions durables.
Ce que j’en retiens pour mon projet :
- Oser l’ambition narrative : ne pas se contenter de morceaux isolés, mais construire un univers.
- Jouer avec les frontières entre musique et technologie : utiliser les nouveaux outils sans perdre l’âme humaine.
- Créer des ponts entre le rêve et la réalité : la musique doit transporter, émouvoir, surprendre.
Synergies et transferts de compétences
Ce que le Product Management m’a appris :
- La rigueur : savoir planifier, prioriser, et tenir des deadlines.
- L’écoute : être à l’écoute des retours, sans perdre de vue sa vision.
Ce que la musique m’a appris :
- La créativité : penser outside the box, oser prendre des risques.
- La résilience : accepter les échecs et en faire des opportunités.
Exemple concret : Grâce au PM, j’ai appris à structurer mon projet musical (calendrier, budget, communication). Grâce à la musique, j’ai appris à innover avec audace dans mon métier (proposer des idées disruptives, prendre des risques calculés).
La musique comme langage de l’âme : une connexion au divin et à soi
La musique est bien plus qu’un assemblage de sons ou une succession de rythmes. C’est un langage universel, une voie d’accès directe à l’invisible, une manière de toucher l’âme sans passer par les mots. Quand je compose, je ne crée pas seulement des morceaux : je cherche à capturer des émotions pures, des états d’être qui dépassent la raison. C’est une forme de méditation active, où chaque note, chaque silence, devient une prière ou une question lancée dans le vide, en quête d’écho.
Il y a quelque chose de sacré dans ce processus. Que l’on croie en un divin, en une énergie cosmique, ou simplement en la puissance de l’inconscient, la musique nous connecte à une dimension plus grande que nous. Elle nous permet de nous perdre pour mieux nous retrouver, de transcender le quotidien et d’accéder à une forme de vérité intérieure. En fermant les yeux et en me laissant porter par les sons, je sens parfois une présence, comme si la musique était un pont entre mon moi conscient et quelque chose d’infini, d’ineffable.
Mais cette connexion n’est pas seulement verticale, vers un au-delà mystérieux. Elle est aussi horizontale, vers nous-mêmes. La musique est un miroir : elle révèle nos peurs, nos joies, nos contradictions. Elle nous permet de dialoguer avec notre ombre, de célébrer notre lumière, et de nous réconcilier avec les parts de nous que nous ignorons ou refusons. En cela, elle est une thérapie, une catharsis, une façon de se réapproprier son propre mystère.
Quand j’écoute un morceau qui me touche profondément — qu’il s’agisse d’un Oxygène de Jean-Michel Jarre, d’un Requiem de Mozart, ou – sans comparaison possible aucune – d’un set improvisé dans mon home studio —, je ressens cette vibration particulière, comme si le temps s’arrêtait. Les frontières entre moi et le monde s’estompent. Je ne suis plus un Product Manager, un compositeur, ou même un individu : je deviens une partie d’un tout, un maillon dans une chaîne invisible qui relie tous les êtres à travers les siècles.
C’est cette dimension spirituelle et intime que je cherche à insuffler dans Connected Dreams. Chaque morceau est une invitation à plonger en soi, à écouter cette voix intérieure que le bruit du monde étouffe trop souvent. La technologie, les algorithmes, les KPI ont leur place, mais ils ne doivent jamais étouffer cette essence première : la musique comme expérience de l’absolu, comme un moyen de se souvenir que nous sommes à la fois poussière et conscience.
Conclusion : et si tout était question d’équilibre ?
Au final, Product Management et composition musicale sont deux faces d’une même médaille : créer quelque chose qui a du sens, que ce soit pour des utilisateurs ou pour soi-même.
- En PM, je construis des produits qui résolvent des problèmes ou qui créent un besoin.
- En musique, je crée des univers qui provoquent des émotions.
Connected Dreams est la preuve que l’on peut concilier les deux, même à quelques années de mes 50 ans. Alors, quel est votre rêve que vous repoussez depuis trop longtemps ?
🎧 Écoutez Connected Dreams : linktr.ee/re_v.on 🔄 Remixez un morceau et partagez-le avec #ConnectedDreams 💬 Partagez vos propres rêves créatifs en commentaire — il n’est jamais trop tard pour se lancer !


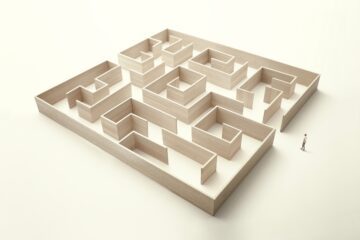
0 Commentaire